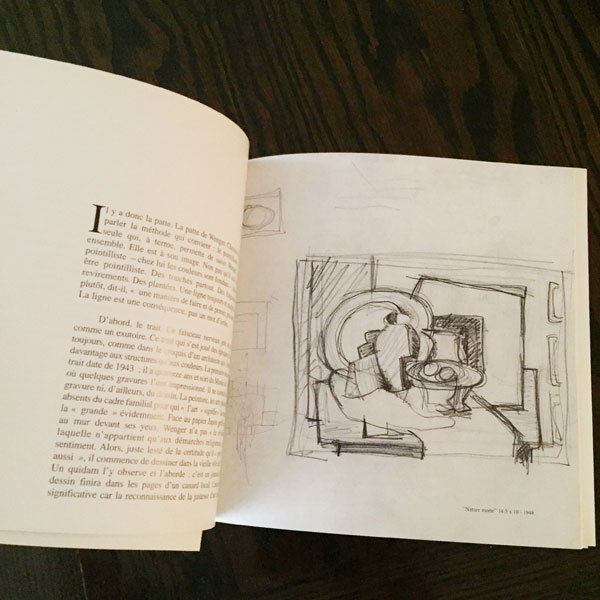
C’est entendu: l’artiste est la synthèse de lui-même. Le produit de ses expériences, de ses audaces, de ses émotions, de ses errances et de sa formation – on a tort de négliger ce fondement de l’être.
Le terreau dans lequel Wenger s’est développé tire son essence de deux sources.
L’une, très éloignée des arts plastiques, lui a donné enfant le spectacle de la rigueur et de la discipline: Paul Wenger, son père chimiste qui deviendra recteur de l’Université de Genève, est l’un des scientifiques d’une famille dont c’est le domaine de prédilection. Plusieurs Wenger plongeront dans la radiologie alors balbutiante, dans la chimie et dans la physique; dans les sciences rigoureuses dont les codes ne favorisent pas l’échappée rêveuse.
L’autre, c’est à Paris que Maurice Wenger la trouve lorsque, ayant négocié son départ avec un père perplexe mais bienveillant, il s’installe à Saint-Germains-des-Prés en plein bouillonnement – à l’aube d’une de ces poussées de génie collectif dont Paris sait nourrir le monde avec constance. Les acteurs de ce temps appellent leur mouvement: existentialisme.
(Paris, 1999, éditions Carré).