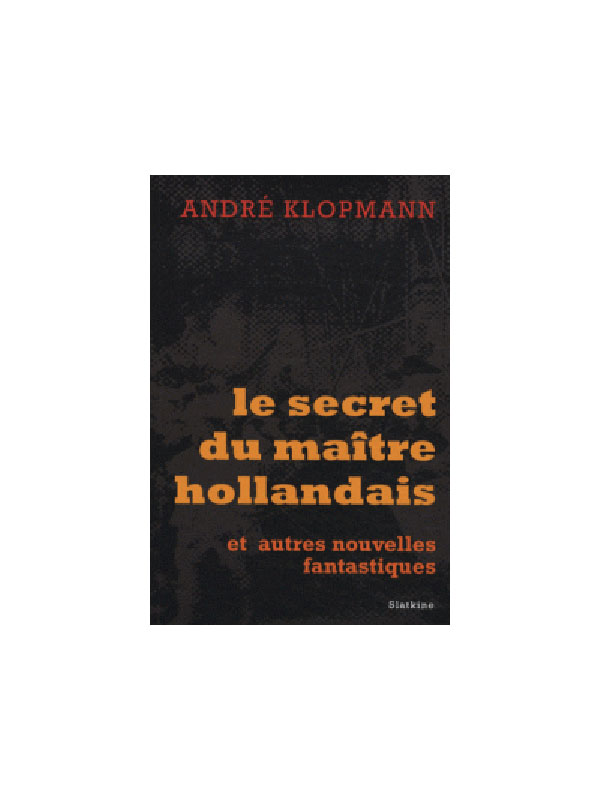
Des heures volées à celle qui manque au lapin d’Alice pour arriver à temps, des affres de la nuit à la révolte des horloges, André Klopmann livre des textes parfois surréalistes. Il nous emmène d’un siècle à l’autre à Genève, Amsterdam ou Meiringen, et nous amuse de ses exercices de style. Au travers d’histoires drôles ou graves, il invite à la réflexion et à la rêverie. Ses nouvelles empruntent à Poe et Buzatti. On y croise Gainsbourg, Carroll, Ionesco et, dans un joyeux détournement, Holmes et Moriarty. Mystères et humour noir… Ces sept récits voyageurs s’inscrivent dans la pure tradition anglo-saxonne de la nouvelle à clé. André Klopmann est haut fonctionnaire et écrivain, Prix du Quai des Orfèvres, Grand Prix FNAC.
Premières lignes :
Je m’appelle Rembrandt Harmenszoon van Rijn et j’ai donné au monde une légende que je regrette d’avoir créée. On ne maîtrise pas toujours son destin. Bien sûr, j’ai goûté aux charmes de la haute bourgeoisie et connu les délices éphémères du respect dont je croyais bénéficier. On se flattait de ma présence en de nobles salons dédiés, souvent, à l’exposition des richesses et à l’expression du pouvoir jailli de l’or accumulé. Je vivais insouciant, vêtu de fins tissus et entouré de pièces d’art, dans une maison cossue qu’il m’a fallu vendre lorsque je ne parvins plus à honorer mes dettes.
Ils m’avaient attiré comme le papillon vers la lumière. Ils étaient mon soleil et j’étais leur Icare. Ils me tenaient. Ils m’ont trahi et plus encore, ils m’ont poussé à me trahir moi-même ; des deux maux, je ne sais lequel est le pire. Le second, sans doute. Il m’ont fait illustre et pourtant, le constat de mon infortune me pèse car j’en sais le prix.
C’est à Frans Banning Cocq que je dois d’avoir tissé le linceul de mon éthique. A cette époque je fréquentais la Compagnie des Guetteurs dont il était le chef. Cette clique d’opérette réunissait le fin du fin de la bourgeoisie locale, enrichie sur terre et mers du commerce du tabac ramené par ballots d’Indonésie. Chaque mois ses membre se réunissaient dans la Maison des Arquebusiers, buvaient force bières et, en armes et en habits, s’en allaient parader dans la ville afin de rassurer ses habitants :
– Dormez, braves gens, il ne vous arrivera rien. Nous veillons. Rien ni personne ne vous attaquera. Faites-nous confiance.
Confiance, tu parles. Souvent mon ami Johannes van Roop, m’avait mis en garde. C’était un apothicaire réputé. Il n’ignorait rien des maux de nos concitoyens et préparait, dans son laboratoire tout encombré de cornues, pots d’herbes, onguents, flasques mystérieuses et grimoires dans lesquels il consignait ses recettes, des remèdes qui l’avaient rendu riche, lui aussi. Mais il fuyait la Compagnie des Guetteurs tandis que moi, je dois bien admettre que son intérêt pour mon art me flattait.
– Mon ami, que vas-tu faire parmi ces gens-là ? insistait souvent van Roop. Ne vois-tu pas qu’ils endorment la ville avec leurs rituels saugrenus ? Qu’ils s’érigent en gardes afin de mieux prévenir, non pas de l’envahissement mais de la révolte intérieure ?
– Quelle révolte ? questionnais-je alors. Mais qui donc se soulèverait ? La ville est prospère, les affaires des Guetteurs florissantes et il n’est pas un bas quartier qui ne profite de leur commerce.
– Quelle rébellion? Eh bien, mon ami, la mienne, par exemple ! Ne vois-tu pas que leur commerce sent le diable ? Mes herbes donnent le teint frais et requinquent les souffrants. Les leurs donnent la peau jaune et la toux amère. Ils font commerce du malheur des gens. Ils disent protéger la cité mais ils ruinent la vie des habitants. Ils ne protègent personne. Le grand théâtre de leurs rondes de nuit, c’est du somnifère dont se repaissent les ignorants. Je ne suis pas ignorant et toi non plus, mon ami. Crois-moi, fuis-les, va au loin, ne les fréquente pas, ne cède pas à leurs sirènes ; sois fort et rappelle-toi Ulysse, souviens-toi d’Icare.
(…)
Premières lignes :
De Films en aiguilles
Chaque soir cinquante-six montres immobiles et vivantes attendaient, rouages ajustés, cœurs battant, la visite de leur bienfaitrice. Et tous les jours à vingt-trois heures, Eve Laramée composait le code secret de son coffre, ouvrait la porte blindée et câlinait à gestes mesurés, sur leur tapis de velours, les montres qui avaient rythmé son temps. Elle s’en saisissait une à une et les remontait avec amour et délicatesse, comme d’autres taillent leurs orchidées. Elle se pâmait devant les ors, le verre, les cuirs et l’acier qu’elle caressait longuement. Souvent, elle tirait la couronne pour changer l’heure. Parfois, elle redonnait vie à l’une d’elle qu’elle avait laissé s’épuiser. On aurait dit une eau-forte du XVIIIe – le thème classique de la bourgeoise en reflet dans le miroir de sa coiffeuse chargée de pots de crème et fioles d’onguents. Elle respirait à leur rythme, elle les écoutait comme si chacune était le miroir d’elle-même, d’un pan de sa vie. Ses montres gardaient avec elle le secret de sa réclusion.
Trente ans déjà qu’on ne l’avait vue en société. Elle avait choisi de quitter la lumière en pleine gloire, après le tournage de La Grande duchesse, afin que jamais le temps qui l’obsédait ne vînt à ternir son image. On n’avait plus découvert d’elle la moindre photo récente. Les paparazzi avaient échoué à percer son mystère. Ainsi conservait-elle dans la mémoire collective l’intense éclat de ses cinquante ans. Les deux entretiens qu’elle avait donnés depuis lors par téléphone ajoutaient, à son mythe, le charme profond de l’insaisissable. Elle avait transformé le plomb en or. Le désir qu’elle inspirait quand, sublime, elle rayonnait sur les écrans croissait à mesure que, dans le secret de sa retraite, son corps souffrant se rendait aux dures lois de la biologie humaine. Elle avait vaincu l’image du temps. Mais le temps… C’était une autre affaire.
– Parlez-moi, mes chéries.
Le tic-tac du chœur des montres répondait à son oreille qui savait les écouter.
(…)